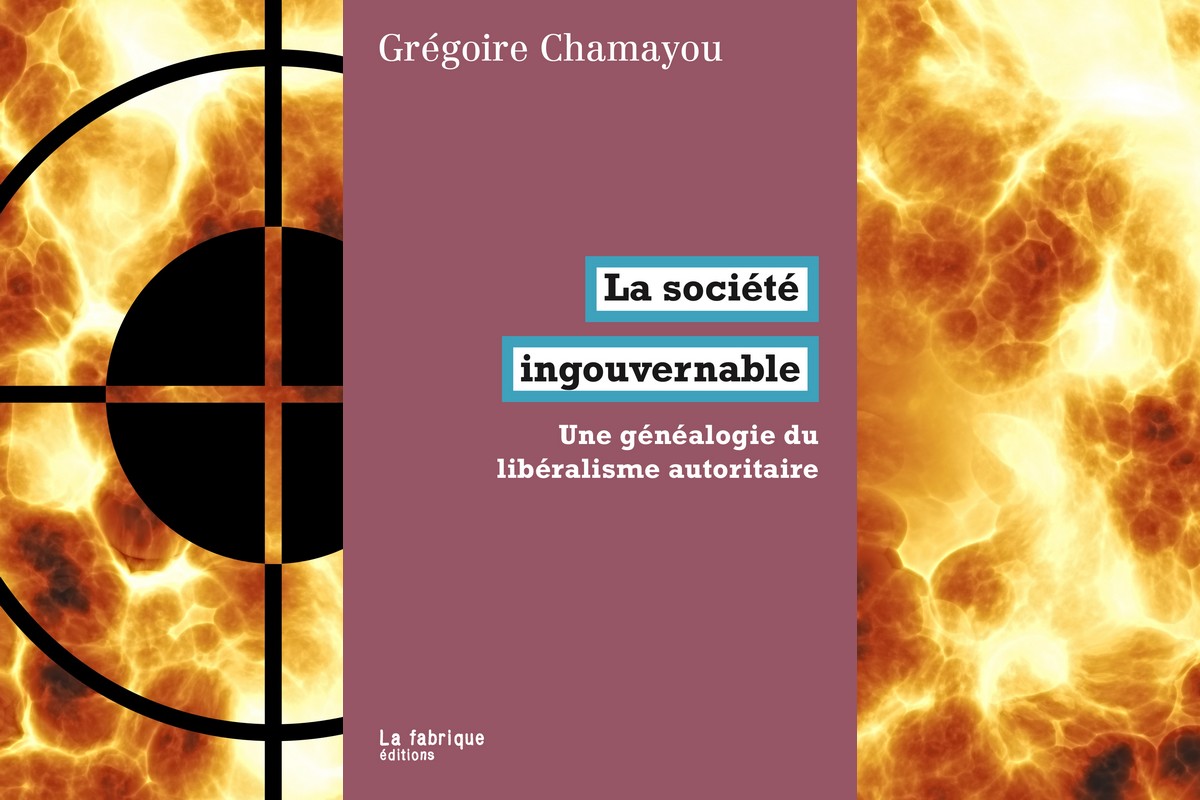La Société ingouvernable de Grégoire Chamayou est un de ces livres rares qui nous laisse à la fin de la lecture plus intelligents qu’au début. Beaucoup d’ouvrages peuvent, en matière philosophique, politique ou sociétale, nous apprendre des choses, souvent des thèses ou points de vues, mais ici, il s’agit véritablement d’intelligence au sens cognitif du terme, à savoir une plus claire compréhension de la société dans laquelle nous vivons, et des raisons qui l’ont conduite à être ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Last but not least, il se lit très facilement, surtout si cet article sous forme de fiche de lecture parvient à vous en donner l’envie.
Temps de lecture estimé : 35 minutes (mais ça vaut le coup)
Les travailleurs indociles
Le thème central du livre est la crise de gouvernabilité qui, au seuil des années 1970, a précédé la crise économique. La « gouvernabilité », entendue comme « aptitude à gouverner la société », non pas dans l’absolu mais « comme on veut la gouverner » – la nuance est d’importance – a subi une crise qui a surtout été jusqu’ici théorisée du point de vue des classes dominantes. Elle trouve son point de départ, et son fil conducteur, dans l’indocilité des travailleurs.
Dès la fin des années 1960, soit plusieurs années avant le choc pétrolier de 1973 traditionnellement retenu comme repère de la fin des « trente glorieuses » et du début de la « crise », le taux de profit avait commencé à chuter aux États-Unis. Le coupable était tout trouvé : l’inflation. La cause : la hausse du coût du travail alimentée par la combativité ouvrière. Il n’en faudra pas plus pour congédier les politiques keynésiennes à la première occasion. Après des décennies de traversée du désert, l’heure avait enfin sonné pour les thèses « néolibérales », celles de Friedrich Hayek en tête, annonçant les tournants brutaux opérées par Ronald Reagan et Margaret Thatcher.
A y regarder de plus près, le récit de cette crise de gouvernabilité sous-tend un second thème central que l’auteur ne mentionne qu’à la fin de son ouvrage, mais qui en fait relie toute l’histoire, sous la forme de cette citation bien connue de Lénine : « l’action précède la théorie ». La première idée reçue en effet, du moins dans l’esprit du profane, auquel l’auteur tord le cou est la supposée influence des « grands » économistes sur l’économie. Aucun d’entre eux ne l’a jamais fait ni de près ou ni de loin, du moins pas de son propre chef. L’impulsion est toujours venue du « on » (celui de « comme on veut la gouverner ») qui puisa allègrement dans le fonds doctrinal disponible en fonction de ses seuls intérêts. Les justifications théoriques sont toujours venues après. L’inflation mange le capital ? Exit Mr Keynes, bienvenue MM. Hayek, Friedman et consorts. C’est aussi simple que ça.
En l’occurrence, le signal d’alarme fut tiré dès 1969 par le Wall Street Journal : « l’état de tension sociale est le pire que l’on ait connu de mémoire d’homme ». Pour la seule année 1970, la grève toucha près de 2 millions et demi de travailleurs aux États-Unis. Le coupable fut rapidement identifié. L’augmentation du niveau de vie montrait ses effets pervers : les autoritarismes de petit chef, les insultes et pressions diverses, naguère tolérables dans une conjoncture d’insécurité économique, étaient tout simplement devenus insupportables. La rébellion contre l’autorité se ressentaient désormais sur la productivité et incidemment sur la rentabilité.
En première réponse à cette situation, le management n’appliqua que ce qu’il connaissait : l’intensification du régime disciplinaire. Mais cela conduisit à la révolte ouverte. Il y avait urgence à imaginer ex nihilo un nouvel art de gouverner le travail.
La deuxième tentative convoqua le pouvoir d’achat. La société de consommation était supposée remplacer les désirs d’action militante par un rêve d’évasion et de propriété. Sur le papier, ça marchait très bien. On imagine alors bien la surprise causée par les mouvements sociaux des années 60. Là encore, l’analyse fut rapide : on avait juste oublié la pyramide des besoins, la fameuse « pyramide de Maslow » : les besoins primaires satisfaits, on assistait à un simple « déplacement de la frustration » vers d’autres objets de revendications. Tout était à recommencer.
Épisode 3 : des réformateurs managériaux imaginèrent de substituer à l’ancienne « stratégie du contrôle » une « stratégie de l’engagement » permettant aux travailleurs de participer aux décisions. L’enrichissement des tâches et l’auto-management n’avait pas vocation à faire plaisir au travailleurs, loin s’en faut, mais juste à éteindre leur désir de révolte. Là pour le coup, ça marchait plutôt bien. Hélas, ce fut cette fois au tour du management traditionnel de monter au créneau : cette stratégie sonnait la fin de leur autorité et du pouvoir despotique des grands et petits chefs.
On se retrouvait dans l’impasse : le régime disciplinaire, que l’on savait désormais contre-productif, ne pouvait être reconduit et l’autonomie, même factice, se heurtait au management qui n’entendait pas de cette oreille d’être dépossédé d’une part importante de ses prérogatives. C’est ici que l’imagination des économistes néolibéraux fut sollicitée, pour accoucher d’une troisième voie promise à un bel avenir : l’insécurité sociale.
La mémoire sociale, théorisent certains, met deux générations à se tarir. Une fois estompée la peur de l’insécurité économique des périodes de grandes crises ou de guerre, les travailleurs savent que les politiques publiques ne les laisseront pas mourir de faim. La « psychologie du comportement » fixe à ce point précis un affaiblissement général de la tolérance à la frustration.
Il fallait réagir. Les thèses néo-libérales fournirent la solution illustrée par la « métaphore de l’ours » : si on donne un bonbon à un ours, il en attend un autre puis encore un autre. A cours de bonbons, l’ours finit par arracher le sachet vide et tout le bras avec : l’ours a été récompensé dans ses activités agressives comme les employés dans leur action collective. On identifia trois piliers à abattre : 1) L’engagement keynésien au maintien du plein-emploi ; 2) La protection sociale et l’État providence ; 3) La puissance des syndicats. Aucun ne devait rester debout.
La révolution managériale
La première offensive fut l’imagination d’une nouvelle gouvernance économique prétendant congédier le principe de l’intérêt personnel, cher à la théorie classique, au profit d’une nouvelle « étique managériale » entièrement refondée. En gros, La « classe capitaliste » était réputée avoir disparue, diluée dans l’actionnariat, de même la propriété privée des moyens de productions. Le capital, et par là même le capitalisme, se serait ainsi auto-dissous dans une nouvelle éthique communale supposée prendre en compte tous les intérêts affectés par les activités de l’entreprise.
On exhuma pour l’occasion un livre quasiment oublié : L’Entreprise moderne et la propriété privée d’Adof Berle et Gerdiner Means. Enfin oublié, pas tant que ça : à sa sortie en 1932, il avait horrifié la classe dominante qui, pour avoir tenté de l’interdire, déclenchèrent l’effet l’inverse en lui donnant une publicité involontaire (un « Effet Streisand » avant l’heure).
La thèse centrale, qui a désormais ses galons dans les cours d’économie tout en restant méconnue du grand public, porte sur la séparation de la propriété et du contrôle de l’entreprise : l’actionnaire, n’ayant plus la possession physique d’un bien productif mais d’un simple titre, une « propriété de papier », n’a plus d’attache ni responsabilité sur l’entreprise. Il en délègue la gestion à un manager, un simple agent qui ne partage pas ses intérêts. Comment le faire travailler dans le sens des intérêts de l’actionnaire, c’est tout l’enjeu du « problème d’agence » mis en lumière par Berle et Means.
Au passage, notre duo a aussi relevé une conclusion savoureuse, celle-là en revanche superbement ignorée par la scolastique libérale : la thèse dite de « l’inadéquation traditionnelle ». Elle consiste à invalider la doctrine classique d’Adam Smith, et sa fameuse « main invisible », non pas contre lui mais au contraire en adhérant à ses thèses. Comment opérer ce petit miracle ? Simplement en relevant que la doctrine a elle-même entrevu sa propre obsolescence. De l’aveu même de Smith, sa « main invisible » ne fonctionnerait que pour le capitalisme entrepreneurial, pas pour la « société par actions » alors marginale et aujourd’hui devenue la norme. Cela méritait d’être relevé.
Pour en revenir à notre propos, beaucoup restaient sceptique envers l’éthique managériale, y compris au sein même de ce courant : si on ne pouvait faire confiance aux managers pour la défense des intérêts des actionnaires, comment pouvait-on le faire pour la visée du bien-être social ? Autre problème, on avait appris des crises antérieures que l’intérêt des travailleurs était insatiable, d’où le caractère supposément intenable de cette promesse. Friedman lui-même avait qualifié de « doctrine fondamentalement subversive » l’idée d’une « acceptation générale, de la part du management, d’autres responsabilités sociales que de faire le plus d’argent possible ». Ces conceptions firent donc rapidement long feu.
Un détail surréaliste reste cependant notable : c’est sur cette thèse aussi vite apparue qu’abandonnée par les libéraux que s’est fondé au même moment l’aggiornamento programmatique de la social-démocratie : le capitalisme étant supposé se socialiser lui-même, l’appropriation publique des moyens de production devenait inutile. L’aliénation des travailleurs étant « inévitable » que la propriété soit capitaliste ou collectiviste(!), la gestion importait plus que la propriété. C’est ainsi que le dépassement du capitalisme finit dans les oubliettes de la gauche de gouvernement.
Le problème d’agence
Pendant que la social-démocratie s’éloignait de ses prémisses, les libéraux, eux, se rapprochaient des leurs. Entre la vision classique de la maximisation des profits et les nouvelles lubies de managérialisme éthique, ils tranchèrent le nœud gordien sans faire plus de manières : le manager est là pour servir les intérêts des actionnaires, point barre. La justification éthique était renvoyée au calendes grecques. Il ne restait donc à régler que l’épineuse question du « problème d’agence ».
La pratique courante des bonus et stock options se comprend dès lors facilement : lier l’intérêt des managers aux bénéfices des actionnaires assure leur docilité. Comme si cela ne suffisait pas, une autre technique a aussi montré son efficacité redoutable : le contrôle des marchés. Partant du postulat qu’il existe une corrélation élevée entre l’efficience managériale et le prix des actions, le moindre repli est sanctionné par un rachat hostile suivi du limogeage du dirigeant. Carotte financière et effet disciplinaire du marché assurent ainsi de concert les juteux bénéfices du « propriétaire absentéiste » qu’est devenu l’actionnaire.
La contrôle des marchés a aussi eu pour effet d’ajouter un deuxième étage à la fusée managériale, notamment sous la pression actionnariale des fonds de pension. Ainsi, à la distance entre l’entreprise de son dirigeant s’ajoute désormais celle entre le dirigeant et ses actionnaires, eux-mêmes dirigés par des gestionnaires de fonds de pension. La récession et à la concurrence internationale achèvent de réaliser la discipline économique. L’ironie est que les travailleurs, en tant d’actionnaires de fonds spéculatifs, s’opposent à leurs propres intérêts en tant que travailleurs.
Marx, sur la fin de sa vie, avait aussi entrevu dans la forme actionnariale cette possibilité de dépassement des rapports de propriété capitalise par sa subordination à une classe boursière et travers elle à un gouvernement supérieur, mais certainement pas à un pouvoir managérial privé.
Le contrôle par les marchés est ainsi devenu l’idéal opposé par néolibéraux au contrôle politique, conscient et finalisé, de l’économie. Friedrich Hayek, théoricien néolibéral et penseur politique majeur du XXe siècle, introduit un néologisme pour se distancer du mot « économie » : la « catallaxie » : « l’ordre spontané produit par le marché ». Sauf que cet « ordre » se révéla tout sauf spontané, et il devra inlassablement être ré-imposé par des stratégies conscientes. A la fin du XXe siècle, le malaise théorique va se doubler de confrontations sociales et politiques.
les « théories de la firme »
Les années 70 virent des attaques frontales contre l’entreprise opérées par divers canaux comme les mouvements sociaux ou l’entrisme dans les conseils d’administration. En réponse, plusieurs tactiques furent développées : pression économique (financement des universités et des médias), lexique (par exemple « l’attaque », qui appelle la contre-attaque, devient des « critiques », qui invitent à l’auto-examen, etc.), campagnes de publicité pour vanter le rôle social de l’entreprise.
Ce discours ne déclencha qu’une double réprobation : la gauche dénonça l’hypocrisie managériale et les néoclassiques redoutaient que les hypocrites ne se muent en hypercrites (ceux qui oublient leur insincérité initiale et finissent par se prendre pour leur masque en perdant toute conscience de leur duplicité). Friedman craint pour sa part que la tactique ne conduise qu’à la régulation publique. Il devenait manifestement nécessaire de développer une philosophie pour donner à l’entreprise la légitimité théorique qui lui faisait défaut.
Une nouvelle exhumation opportune y contribuera, cette fois celle d’un article publié en 1937 par l’économiste Ronald Coase. Ce dernier observa que les entreprises fonctionnaient sur des principes opposés à ceux sur lesquels reposaient leur légitimation : la décision autoritaire contre l’automatisme des marchés, la hiérarchie contre l’échange, etc. La justification de Coase était que l’échange économique avait un coût (prospection, négociation, contrôle…) et que la raison d’être de l’entreprise était de les éliminer, justifiant ainsi la décision autoritaire. Les néoclassiques furent séduits par la théorie des « coûts de transaction »,beaucoup moins par son corollaire autoritaire nettement moins présentable. Les théories de la firme mobilisent encore aujourd’hui d’infinis cortèges d’arguties scolastiques, présentant comme des doctrines « neutres » ce que leurs auteurs avaient explicitement conçu au départ comme des armes intellectuelles élaborées pour la défense d’un capitalisme contesté. Il s’agissait surtout d’abattre ces deux grandes prémisses intellectuelles : 1) la séparation de la propriété et du contrôle ; 2) la responsabilité sociale des entreprises.
La firme se voulait désormais conçue comme un « nexus (nœud en latin) de contrat » : ce n’était plus une entité réelle, mais un simple nom donné à un ensemble de « relations contractuelles » librement consenties. La principale propriété de cette fiction était d’ invalider la thèse autoritaire de Coasse. L’impasse logique était que l’entreprise ne peut à la fois être présentée comme un « nexus de contrat » et comme une entité contractante elle-même. Qu’importe, l’enjeu principal était politique. Il s’agissait d’ôter à la firme toute réalité tangible et en même temps de la dépolitiser, afin de disqualifier par avance toute critique contre elle. De fait, la manœuvre permit de liquider toutes les constructions intellectuelles antérieures. Elle ouvrait cependant la porte à de nouvelle difficultés.
Notamment, l’actionnariat n’avait plus rien à voir avec la conception classique de la propriété : les actionnaires ne sont en effet pas plus propriétaire de l’entreprise que des produits qu’elle vend, seulement d’un droit de vote à l’assemblée générale et d’un droit aux dividendes. Ils ne peuvent davantage se prévaloir d’une rémunération d’un risque, achetant et vendant les actions à leur gré. Dans ces conditions, qu’est-ce qui justifiait la prééminence des intérêts actionnariaux ? Plusieurs théories plus ou moins bancales tentèrent de répondre à cette nouvelle difficulté, mais l’égoïsme et l’égotisme célébrés comme vertus cardinales n’étaient pas vendeurs. Il fallut alors aller chercher d’autres concepts.
Le contre-activisme d’entreprise
La crise Nestlé de 1974 fournit un cas d’école à la nouvelle doctrine qui se mettait en place. Cette année-là, un rapport incrimina la multinationale pour sa campagne commerciale agressive de lait en poudre en Afrique, qui poussa de nombreuses mères non informées à abandonner l’allaitement et à provoquer la mort de nombreux nourrissons en mélangeant le lait en poudre à de l’eau non potable. Nestlé commis d’abord l’erreur de sur-réagir sur le plan juridique. Acculée, elle se décida à faire appel à des consultants qui les amenèrent à sortir du seul cadre qu’ils connaissaient, le business, pour s’aventurer sur le terrain de leurs attaquants qui leur était inconnu : l’action politique.
De nouvelles tactiques de contre-activisme fut expérimentées, comme celle de mener des actions ne contribuant pas directement à la stratégie de la firme, dans le seul but d’éparpiller les efforts des activistes. Mais la principale, qui fera figure de modèle pour l’avenir, sera de fissurer le front adverse afin de lui retirer un à un ses « blocs de crédibilité ». Pour cela, les consultants ont élaboré une typologie des activistes : les radicaux, les opportunistes, les idéalistes et les réalistes.
La tactique est d’une simplicité désarmante : 1) ne pas se préoccuper des radicaux : ils ont des mobiles politiques ou socio-économiques sous-jacents. Avec eux, rien à faire ; 2) Négocier avec les réalistes, le pain bénit. Pragmatiques, ils sont toujours ouverts au compromis ; 3) convertir les idéalistes en réalistes. Il suffit pour cela de leur démontrer que leur position entraîne pour d’autres un revers non éthiquement justifiable. Altruistes et sincères, ils sont crédibles mais aussi crédules ; 4) Rallier les opportunistes, la clé pour eux étant de leur fournir au moins l’apparence d’une victoire partielle.
En résumé : négocier avec les réalistes, rallier ensuite les idéalistes et les opportunistes. Les radicaux se retrouvent ainsi isolés, privés de la crédibilité que les idéalistes leur apportaient. Le postulat est en effet qu’ils ne tirent leur force que du rapprochement avec des blocs plus modérés. Privé de ce lien et isolés dans leur niche, ils deviennent un « folklore minoritaire » négligeable.
Enfin, la nouvelle tactique est fondée sur le dialogue. La tactique consiste à mener d’interminables négociations qui présentent l’avantage de redorer le blason de la firme, tout en déplaçant le débat sur le terrain des interprétations pour plonger les contestataires dans de fastidieux pourparlers et les occuper à autre chose qu’à boycotter.
Le « dialogue » ne vise pas à négocier mais à convaincre les gens « raisonnables » de votre point de vue. Face en effet à un public ayant appris à se méfier des relations publiques construites comme des « fabriques du consentement », il s’agit de renforcer, dans la forme, la dignité et le respect des deux parties. Pour cela un nouveau glossaire est mis en place : écoute réciproque, entente mutuelle, communication relationnelle, consensus, co-création d’une compréhension partagée entre les parties prenantes, horizontalité, reconnaissance, rapport à l’autre, etc.
La dialogie dominante (dialogue en tant que stratégie du pouvoir) doit remplir six fonctions : 1)Renseignement (identifier les problèmes potentiellement controversés avant qu’ils n’atteignent l’arène publique) ; 2) Cantonnement (relocaliser la confrontation dans un forum privé, la confiner loin de l’espace public) ; 3) Diversion (donner aux opposants un os à ronger pour mieux les détourner des tâches offensives) ; 4) Cooptation (offrir du pouvoir – gloire, argent – aux réalistes les plus tapageurs) ; 5) Disqualification (inclure les consensuels et du même coup exclure les dissensuels « incapables de dialoguer ») ; 6) Légitimation (bénéficier du « transfert d’image » en dialoguant avec des opposants respectables).
Le management des problèmes
Malgré ces efforts, une simple posture défensive face aux assauts adverses ne suffisait pas. Il fallait aussi influencer les politiques publiques contre la « régulation gouvernementale excessive ». C’est dans cette ambition explicite qu’une nouvelle branche du savoir managérial apparu en 1977 sous le nom de « management des problèmes », autrement dit le « management de la politique publique par l’entreprise ». Sous couvert de « pluralisme » de points de vues publics et privés, il s’agissait en fait d’imposer la prééminence politique des intérêts du capital. Le lobbying devint systématique.
Ici s’ouvre un troisième moment le l’histoire de l’entreprise. Après le managérialisme des années 50-60 (analogie du gouvernement d’entreprise avec le pouvoir d’État), le néoclassissisme des années 70 (gouvernance économique réduite au « problème d’agence »), le « planning corporate à long terme » ne se limite plus au seul business mais ajoute un art du management stratégique de l’environnement socio-politique général (« environnement total »). Un des premières entreprises à adopter cette stratégie fut Monsanto.
La règle d’or est d’exercer une veille stratégique pour identifier les problèmes émergents et ne jamais permettre à ceux menaçant la survie et le croissance d’une entreprise d’atteindre la phase de crise. Parmi les moyens pour imposer la prééminence politique des intérêts du capital : un processus à long terme de diffusion et d’adoption des idées dans le domaine public planifié en trois grandes étapes : 1) Création (incubation de l’idée dans des cercles académiques restreints) ; 2) Imprégnation (diffusion dans la sphère intellectuelle par les articles, les rapports, les livres, les cours et séminaires ; 3) Dissémination large (les médias relaient au grand public).
Cette théorie se traduisit cependant par des contre-attaques en ordre dispersé, sans unité doctrinaire. Une synthèse était nécessaire entre les thèses néolibérales et le nouveau paradigme nécessitant une expertise politique. Ainsi naquit la « théorie des parties prenantes ». Loin de n’être qu’une simple « idéologie », cette théorie fournit au management à la fois le lexique d’un discours éthique et les outils pour une gestion stratégique de la contestation. Les « parties prenantes » ne sont pas identifiées selon un point de vue éthique (critère de prise en compte indépendant des considérations de puissance) mais stratégique (seules comptent la puissance ou la capacité de nuisance). Celles qui ont recours à des tactiques coercitives (grèves, etc.) sont exclues.
Ainsi l’ANC de Nelson Mandela fut exclue, classée « terroriste ». Pour contourner le problème de conscience, les auteurs affirment que « identifier n’est pas reconnaître » (ce qui revient à délégitimer et autorise la répression). L’ANC fut classée « partie prenante dangereuse » pour son recours au pouvoir coercitif. En l’abandonnant, elle passe au statut de « partie prenante dépendante »» (c’est-à-dire sans pouvoir autonome). En clair, « les parties prenantes dangereuses sont illégitimes » s’entend comme « seuls des inoffensifs peuvent être réputés légitimes ». Le dilemme de la reconnaissance ne laisse que deux choix : puissance illégitime ou légitimité impuissante.
Nouvelles régulations : la « soft law »
Le terme « multinationale » fait son apparition dans le discours public dans les années 1970. Pour la première fois depuis l’invention du mot « souveraineté », il n’y avait plus de congruence entre l’unité politique territoriale et l’unité économique. En 1972, un groupe d’experts mandatés par l’ONU énoncèrent l’objectif – à terme – d’un « accord général sur les multinationales ayant force d’un traité international ». Bien qu’un tel accord fut pourtant qualifié de « prématuré », la déclaration suffit pour déclencher un branle-bas de combat dans les milieux d’affaires. Ce fut à cette occasion que des juristes se mirent à thématiser la notion, aujourd’hui devenue centrale dans la nouvelle gouvernance capitaliste, de « soft law« , la « loi douce ».
En pratique, il s’agissait d’anticiper la « loi dure », autrement dit contraignante, par l’adoption volontaire de codes de conduite, une sorte de « droit sans obligation juridique » (un non-sens sémantique). La manœuvre est classique : étaler sa bonne volonté éthique pour éviter la contrainte juridique. Loin en fait d’une bonne volonté, il s’agissait bien une mauvaise volonté à être régulés. La soft law devient l’instrument majeur d’une stratégie d’évitement de la régulation. Le danger était que chaque bénéficiaire produise son « mou » et s’efforce ensuite de le rendre « dur ». On assista à une course au « code » pour jouir d’un avantage tactique. En 1976, l’OCDE prit l’ONU de vitesse avec ses Principes directeurs pour la entreprises multinationales, recommandations non contraignantes, aux formulations « larges et parfois ambiguës ».
Un double standard fit son apparition : les partisans de l’autorégulation mettent en avant que, le cadre juridique de l’État-nation étant de facto dépassé, l’ordre international étant l’arbitre suprême, toute tentative de régulation contraignant à cette échelle était vouée à l’échec et seule resterait l’option du code de conduite. Pourtant, lorsqu’il s’agit des droits corporate (par exemple les droits de propriété intellectuelle), le droit international sait produire des accords contraignants, la soft law étant cantonné aux droits sociaux.
Dans une ultime phase, les codes de conduite, arme prévue à l’origine pour contrer des régulations en gestation, devinrent une arme offensive pour déréguler activement, non pas contre la volonté étatique, mais sous l’impulsion même des gouvernements néolibéraux. David Cameron en 2006 dans un discours patrons britanniques : « plus les compagnies adoptent volontairement des pratiques responsables […], plus l’appel à un allégement du contrôle et de la régulation devient crédible ».
La rhétorique des Coûts / bénéfices
La rhétorique de la crise, instrument d’une « pédagogie de la soumission à l’ordre économique », justifiait de revenir sur les concessions sociales arrachées dans la phase précédente. Mais, à la différences des bourrins ultra conservateurs, les dérégulateurs des années 70-80 choisirent une tactique oblique : le problème n’aurait pas tant été la régulation que la « sur-régulation ». Où fixer le seuil ? Au point où « les coûts incrémentaux égalent les bénéfices incrémentaux », en clair au-delà duquel les coûts pour la société excèdent les bénéfices.
Concrètement, s’il coûte plus cher à l’entreprise de réduire ses émission de fumées qu’aux victimes de soigner leurs maladies respiratoires, alors l’industrie pourra continuer à polluer. « Mieux vaut guérir que prévenir ». En 1978, un tribunal de Louisiane révoqua un standard abaissant des taux cancérigènes d’exposition au benzène au motif que, si le risque était bien reconnu, l’agence qui a promulgué le standard n’a néanmoins pas pu le chiffrer. Ce jugement surréaliste insinua le principe coûts/bénéfices dans la jurisprudence américaine. Le standard ne sera rétabli que 10 ans plus tard, délai qui aura « coûté » plus de 200 morts.
Un problème épineux se posait toutefois aux économistes : comment estimer monétairement les dommages causés à l’environnement, à la santé ou à la vie, sachant qu’il est impossible d’évaluer monétairement les biens hors marché ? On théorisa deux approches : l’estimation par les « revenus futurs actualisés » (Discounted Future Earnings ou DFE) ou par le « consentement à payer » (Willingness To Pay ou WTP). Dans le premier cas, on calcule le total des revenus futurs dont le décès précoce vous prive (la valeur de la vie est ici réduite aux revenus. Ainsi la valeur d’une femme au foyer est nulle, celle d’une personne âgée minime. Il y a même des cas « déficitaires » quand les dépenses médicales excèdent les revenus). Dans le deuxième cas, on prend en compte le prix que l’individu est prêt à payer pour rester en vie. La question est évidemment insoluble, ce n’était rien d’autre qu’une « tactique de sphinx » (paralyser l’adversaire en le mettant en position de répondre à une question insoluble ou de sauter dans le vide) comme l’avoua à demi-mots le promoteur de cette théorie au jeune Al Gore devant une commission sénatoriale.
Coûts privés et coûts sociaux
La question des de coûts n’avait pas fini de faire couler de l’encre. En 1950 parut un livre novateur : Les coûts sociaux de l’entreprise privée par William Kapp, un auteur hétérodoxe dont le nom a depuis été rayé de l’histoire de la pensée économique.
Kapp distinguait deux types de coûts pour les entreprises : ses coûts privés (équipements, matières premières, salaires, etc.), et ses coûts sociaux (pollution, transport des travailleurs, logement, éducation, retraite, enterrement, maladie, soin des orphelins, etc.). La valeur capitaliste repose en grande partie sur l’externalisation des coûts sociaux non comptabilisés par l’entreprise. Il allait ainsi dans le sens de Sismondi qui déclarait dès 1827 que « le bénéfice d’un entrepreneur de travaux n’est quelquefois autre chose qu’une spoliation […] ; il ne gagne pas parce que son entreprise produit beaucoup plus qu’elle ne coûte, mais parce qu’il ne paie pas tout ce qu’elle coûte ». Les indicateurs de prix seraient donc mensongers, et les luttes sociales trouvent leurs racines dans le refus d’endosser les coûts sociaux de la production privée, en clair de payer pour le capital.
Un économiste libéral rédigea au début des années 1950 une critique au vitriol du livre de Kapp. Son argument : il faudrait mettre en balance les coûts sociaux avec ceux de l’alternative, les « coûts de l’élimination des coûts ». En clair, il faudrait comparer le coût social du produit à la valeur de ce même produit dont le coût social rend la production possible. L’argument allait devenir le trope central de la critique néolibérale de la régulation sociale et environnementale, tout entière fondée sur le principe de symétrisation du remède et du mal.
De tels calculs butent toutefois sur deux écueils. Ils présupposent d’abord qu’il soit possible de recenser de façon exhaustive les dommages sociaux et environnementaux liés à une activité déterminée. Ces coûts sont envisagés comme des dommages finis, circonscrits dans l’espace et le temps. Or la pollution est au contraire caractérisée par sa non-finitude aussi bien dans l’espace que dans le temps (les dommages peuvent persister longtemps après leur première manifestation). Ils présupposent ensuite de pouvoir les mesurer adéquatement selon la valeur marchande. Or, au-delà de l’incommensurabilité des dommages, se pose le problème de la chaîne de causalité qui, dans un écosystème, est cumulative (les sources de pollution se combinent et, à un seuil critique, une seule portion d’émission supplémentaire peut avoir des effets non-linéaires).
Les libéraux convoquent volontiers le « théorème de Coase » : soit un médecin poursuivant son voisin confiseur parce que le bruit de ses machines l’empêche de travailler. Quel que soit le vainqueur, rien n’empêche le débouté d’acheter à l’autre, qui le droit de continuer à faire du bruit, qui le droit au calme. Dans les deux cas, cela est supposé démontrer une « symétrie fondamentale dans les relations » et que le fait de savoir qui paie est une question « économiquement indifférente ». La régulation gouvernementale serait ainsi superflue face à l’autosuffisance d’un ordre privé fondée sur le marchandage des droits. Sauf que la différence de revenus créée une asymétrie du pouvoir de négociation et, à défaut de règle juridique, la décision est abandonnée à l’arbitraire des inégalités économiques.
En tout état de cause, l’idée de mettre en place de nouveaux marchés sur lesquels s’échangeraient des droits à polluer était lancée. Elle n’était cependant pas encore mûre politiquement. Il faudra attendre les années 1990 pour que ces marchés fussent expérimentés aux États-Unis. Ce fut un cas assez inédit de « marchés artificiels » créés de toutes pièces à partir de la théorie économique.
La « tragédie des biens communs »
La critique écologiste reprochait à l’économie capitaliste de ne pas comptabiliser les coûts sociaux et environnementaux. Les néoclassiques les prirent au mot en répondant que si ces coûts doivent être pris en compte, il faut alors bien leur assigner un prix. Refusant le principe d’une évaluation politique, il ne restait que l’estimation marchande. Sous couvert de concession à l’écologie, le mobile essentiel était en fait une nouvelle extension du domaine de l’appropriation privée.
Confier au marché la tâche de réallouer des droits environnementaux bute cependant sur des limites structurelles indépassables : la capacité de chaque agent à estimer les conséquences d’une pollution, la non-représentation des générations futures avec le risque de reporter sur elles une perte qui ne le concernera plus, le critère du consentement à payer structurellement distordu par les inégalités économiques. On aboutit ainsi nécessairement à entretenir un cercle vicieux où l’inégalité économique attire une inégalité environnementale qui aggrave encore la misère réelle des dépossédés.
Cela a surtout pour effet d’amoindrir la richesse publique selon le paradoxe de Lauderdale qui dit en substance que la richesse publique n’est pas la « somme des fortunes particulières », mais qu’au contraire la valeur privée ne peut s’accroître qu’aux dépens de la richesse publique. Pour qu’une chose soit « propre à entrer dans la richesse individuelle », son agrément et son utilité ne suffise pas : il faut de plus qu’elle se trouve dans un certain degré de rareté ». Là est le paradoxe : l’accroissement de la richesse privée mesurée à l’aune de la valeur d’échange présuppose les rareté des biens publics correspondants, quitte à les raréfier artificiellement soi-même en organisant sciemment leur destruction. Que la raréfaction ait été intentionnellement organisée ou qu’elle se produise au titre d’effet secondaire structurel d’une externalisation des coûts sociaux, le résultat est le même.
Ainsi, dans une fantastique inversion de la réalité, les néolibéraux présentent l’appropriation marchande des ressources naturelles comme la condition de leur sauvegarde face à une gestion publique réputée vouée à l’échec. De là vient la fiction de la supposée « tragédie des biens communs » encore vivace de nos jours.
La crise de gouvernabilité des démocraties
En 1975, le Commission trilatérale publia un texte qui fit scandale, La Crise de la démocratie, rapport sur la gouvernabilité des démocraties. Les conservateurs voient dans les politiques keynésiennes de l’après guerre et les mouvements sociaux les « deux menaces endémiques pesant sur la démocratie ». Leurs effets combinés alimenteraient une « inflation des attentes sociales », une « spirale des revendications » exerçant une pression irrésistible sur le pouvoir politique. Étant donné la « disparité entre le volume des revendications et les capacités du gouvernement », les attentes sont vouées à être déçues, les concessions de l’État-providence ne faisant qu’aiguiser de nouveaux appétits. Voilà le cercle vicieux : l’État, cherchant à contrer l’érosion de son autorité par une expansion de son activité, nourrit par là des attentes qui, frustrées, se traduisent par une nouvelle perte de légitimité, qu’il cherche à compenser par les mêmes moyens, relançant ainsi un cercle infini où plus l’activité gouvernementale s’étend, plus l’autorité de l’État s’affaiblit.
Certains théoriciens voient dans cette hypertrophie grandissante de l’État-providence l’effet normal du fonctionnement du marché électoral. Le problème ne tiendrait pas à la faiblesses des gouvernants mais à une « dynamique interne de la démocratie elle-même ». Face à ce constat, un nouveau courant, « l’école du choix public », propose dans les années 1970 d’étendre le paradigme du marché au champ politique. Le candidat à une élection apparaîtrait comme un entrepreneur politique échangeant des promesses contre des voix sur un marché où plusieurs partis « se font périodiquement concurrence dans des élections pour le contrôle de l’appareil gouvernemental ».
La racine du mal est identifiée comme une contradiction entre les deux missions fondamentales de l’État capitaliste :sa fonction d’accumulation et sa fonction de légitimation. D’un côté, il doit aider les investisseurs à accumuler davantage de capital, de l’autre il doit assurer une loyauté de masse envers le système. Or, le dilemme vient des tendances auto-destructrices du capital. En d’autres termes, l’État doit garantir en amont les conditions de l’accumulation que le capitalisme privé met à mal, puis agir en aval pour maintenir son hégémonie sans toucher aux principes fondamentaux qui le déterminent ni empiéter sur sa primauté : que l’État cherche à remplir efficacement sa fonction de légitimation et il se heurte à l’opposition immédiate du capital.
La « crise de gouvernabilité de la démocratie » est le nom donné par les néoconservateurs à la question de savoir comment restaurer la gouvernabilité de l’État sans toucher aux rapports capitalistes. A la fin des trente glorieuses, l’État social était parvenu à une limite où il ne pouvait plus espérer conserver son pouvoir de régulation et d’arbitrage qu’en allant à l’épreuve de force avec la bourgeoisie. Toute critique de l’économie politique étant pour les conservateurs forclose par principe, la reconquête passait nécessairement par la remise à plat de l’État-providence, de l’intervention publique et de la démocratie représentative.
La dictature libérale
La menace ainsi analysée comme une incompatibilité structurelle entre la forme de démocratie politique occidentale et le système de marché, certains économistes imaginèrent le « capitalisme fasciste » idéal. Une bonne dictature libérale (NB : « libéral » pris ici au sens strict de « libre disposition de sa propriété ») doit museler efficacement toute activité politique, ne pas intervenir dans l’économie, ne rien planifier, ne pas accepter de pots-de-vin, confier l’économie aux libéraux, contrôler strictement la masse monétaire, couper les crédits à l’aide sociale et juguler l’inflation. La liberté politique étant réduite à néant, les inégalités économiques tendent à s’accroître.
Le 2 novembre 1973, mois d’un mois après le coup d’État chilien, le Wall Street Journal s’enthousiasmait : « Un certain nombre d’économistes chiliens qui ont étudié à l’Université de Chicago, connus à Santiago sous le nom de « Chicago School », s’apprêtent à se déchaîner. Ce serait là une expérience que nous regarderions avec grand intérêt d’un point de vue académique ». Friedman rencontre Pinochet en 1975. Hayek est reçu à son tour en 1977. De retour en Europe, il justifie la dictature comme un « moindre mal » pendant une » période de transition » : « je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme. »
Ce redécoupage conceptuel permet la formulation d’énoncés pour le moins paradoxaux : si la dictature devient libérale (au sens ci-dessus), la démocratie est quant à elle dénoncée comme « totalitaire ». Là encore, il convient d’entendre ce terme au sens néolibéral. Le totalitarisme est, selon Hayek, un système qui, à la différence du libéralisme et de l’individualisme, « entend organiser l’ensemble de la société et toutes ses ressources » vers une « fin unitaire » (La Route de la Servitude, 1944). En clair, est « totalitaire » une société qui entend redistribuer les ressources à la totalité de sa populaire au mépris de la « libre disposition de sa propriété ».
La dictature de Pinochet est définie comme un régime « autoritaire », de loin préférable aux régimes « totalitaires » tels que définis ci-dessus. Pour les néolibéraux, la destruction de la liberté politique est « regrettable » mais ne saurait être mise en balance avec la liberté économique pour le capital. Pour Hayek, il faut absolument poser des bornes aux régimes parlementaires qui, de la démocratie libérale, tendent à glisser vers le « démocratie illimitée » et de là vers la démocratie totalitaire (La Route de la servitude).
Le libéralisme, soutient Hayek, se fonde sur « un ordre autogénérateur ou spontané dans les affaires sociales »opposé à la tyrannie politique d’une « direction consciente » de la vie économique. Mais cet ordre naturel requiert en réalité, pour se maintenir, l’artifice d’un « interventionnisme continu, organisé et contrôlé à partir du centre ». Les théories de la « crise de gouvernabilité de la démocratie » ne sont rien d’autre que l’expression du déni des contradictions internes du capitalisme et leur renvoi à des causes externes. La solution néolibérale est alors de « limiter la démocratie ».
Aux sources du libéralisme autoritaire
Pour dissiper le paradoxe de la « démocratie totalitaire », Hayek distingue deux « libéralismes » : celui de la liberté individuelle à la mode anglo-saxonne, pour lui authentique, et celui des Lumières et de la Révolution française, pour lui l’ancêtre du socialisme. La démocratie propagée par la Révolution française est réputée déboucher sur le règne de la foule. L’opposition entre « démocratie libérale » et « démocratie totalitaire » n’exprime pour Hayek, au fond, que « l’antagonisme entre libéralisme et socialisme ». Son analyse s’inspire du concept « d’État total » développé par Carl Schmitt durant les débats de la République de Weimar.
Schmitt avait introduit la formule « d’État total » au début des années 1930 en détournant le stato totalitario fasciste – adjectif alors employé positivement – pour l’appliquer de façon péjorative à la démocratie parlementaire. En substance, l’État-providence serait contraint d’étendre ses prérogatives à tout un ensemble de questions sociales et économiques qui n’étaient pas jusque-là du ressort de la puissance publique. Sa sphère devient « totale », au sens de « qui intervient dans tous les domaines de la vie », parce qu’un gouvernement démocratique est continuellement sommé de « répondre aux exigences de toutes les parties intéressées ». Cette extension du champ de l’État ne serait en rien une manifestation de force mais de faiblesse, d’abord parce qu’il croît de façon passive en devenant le jouet d’intérêts sociaux qui en prennent possession par le bas, ensuite car plus sa sphère s’étire, plus sa force s’atténue et il perd toute transcendance.
Le 23 novembre 1932, Schmitt prononça une conférence titrée « État fort et économie saine » à l’invitation d’une organisation patronale, qui joua un rôle déterminant pour rallier le patronat allemand à l’option nazie. Il distinguait deux formes « d’État total ». « L’État total quantitatif », (par son étendue) était la forme « faible ». « L’État total qualitatif », qu’il appelait de ses vœux, mettait en avant l’énergie comme le stato totalitario fasciste. Cet État fort doit concentrer les moyens militaires et la communication de masse pour réduire toute résistance et laisser tout le reste, à commencer par l’économie, à la sphère privée.
Schmitt admettait donc quelques inflexions par rapport aux dogmes libéraux classiques. La non-ingérence inconditionnelle de l’État, « l’État minimal », laisse la place à un État « fort »requis pour la dépolitisation, c’est-à-dire le retrait de l’État des sphères non étatiques. Également, la vision libérale classique d’une société civile atomisée en agents économiques individuels est remplacée par une vision où, entre l’État et le marché, s’intercale un domaine intermédiaire régi par l’auto-gouvernement privé de grands corps patronaux.
c’est en réaction à ce discours que Hermann Heller, juriste social-démocrate mort en exil, évoqua l’invention d’une nouvelle catégorie politique : le libéralisme autoritaire. Hayek, pour sa part, a toujours loué les analyses de Schmitt en critiquant ses choix politiques « tant au plan moral qu’intellectuel ». Ça ne l’empêchera pas de soutenir les régimes de Salazar et de Pinochet. Au grand dam des néolibéraux, l’après-guerre sera keynésien durant trois décennies. Mais les turbulences sociales et politiques de la fin des années 1960 vont annoncer leur réaction pour la promotion d’un « État fort » pour une « économie libre ».
Détrôner la politique
C’est par cette formule que s’annonce la stratégie du néolibéralisme visant à prévenir la « démocratie illimitée » vouée à l’autodestruction par sa vulnérabilité excessive à la pression d’intérêts particuliers. La restriction du champ gouvernemental passait par une interdiction gravée dans le marbre de la loi fondamentale d’empiéter sur l’économie. Le principe d’élections « libres » restait concevable, à condition que le champ de décision des gouvernants qui en seront issus soit verrouillé en amont. Dans la zone interdite : la redistribution des richesses. Interdiction absolue de toucher à l’ordre « spontané » des inégalités sociales.
Une des clés de la stratégie institutionnelle consiste à jouer sur les échelles de pouvoir : transfert vers le haut du verrou constitutionnel, et vers le bas, par la décentralisation, de tout un pan des anciennes fonctions de l’appareil d’État. S’agissant de la construction européenne, Hayek imaginait dès 1939 la mise en place d’un système fédéral comme une voie royale pour une « restriction du pouvoir et de l’étendue du gouvernement » par le biais d’une constitutionnalisation économique de la politique à l’échelon supranational.
Il restait cependant à contrer la dynamique du champ électoral pour imposer ces limites. L’arme principale était des programmes permettant aux classes moyennes de réduire leurs impôts. C’est à ce moment qu’est lancée l’offensive idéologique sur le thème de « l’équilibre budgétaire » et de la « lutte contre les déficits », une fable destinée en fait au contrôle des dépenses de l’État. Car derrière sa « surcharge », il y a surtout celle des prélèvements obligatoires sur le capital. Pour les libéraux,le déficit n’est pas un problème en soi : un faible budget déficitaire reste préférable à un budget important équilibré. Laisser filer un déficit est même vu comme une tactique délibérée pour empêcher les futures administrations d’adopter de nouveaux programmes de dépenses. C’est la politique de la caisse vide tout en agitant la dette comme un épouvantail idéologique.
Un nouveau phénomène économique ouvrait cependant d’autres perspectives : la dépendance aux marchés financiers privés crée des pressions supplémentaires en faveur de politiques conservatrices respectueuses du capital et rend plus difficiles les politiques égalitaires de répartition des revenus. Le problème de la gouvernementalité des démocraties avait trouvé sa solution logée au cœur des régulations monétaristes. Une des innovations majeurs du néolibéralisme a été de concevoir le marché, non plus simplement comme ce qui réalise l’allocation optimale des ressources dans la sphère réputée autonome de l’économie, mais comme un principe politique d’ordre et de gouvernabilité. La même formule était finalement appliqué aux managers de l’État qu’à ceux des entreprises : un rapport d’agence sanctionné par les marchés qui, en même temps qu’ils remplissent leu fonction spéculative, exercent une fonction de police.
Cela ne réglait toutefois pas la combativité sociale. Pour la faire refluer, un nouveau discours présenta le capitalisme et la démocratie comme synonymes face à l’État « bureaucratique ». Profitant de la crise de l’État-providence et de la frustration populaire, l’offensive contre la démocratie pris la forme d’une lutte « pour » la démocratie redéfinie sous l’angle d’une récupération par le « peuple » des « droits » que l’État lui aurait « confisqué ». La démocratie était ainsi redéfinie comme le nom d’un individualisme libéral opposé au collectivisme étatique, le Demos comme un ethnos à l’identité menacé par la « société permissive », dans l’objectif de construire un consentement populaire actif autour du populisme libéral-conservateur.
Mais derrière l’abstraction appelée « dépense », il y avait des besoins réels de personnes qui n’allait pas se laisser dépouiller sans rien dire. Au début des années 80, les gouvernements néolibéraux le savent et se préparent à une confrontation qui allait nécessiter des tactiques plus fines.
La micro-politique de la privation
Les grandes lignes du programme néolibéral étant posées, il restait à gérer les oppositions prévisibles. Entre le césarisme et le gouvernement kamikaze prêt à dilapider son capital électoral, certains imaginèrent une troisième voie, la « micro-politique ». Le principe repose sur l’art de provoquer, par des mécanismes d’incitations économique, des micro-choix individuels dont l’effet cumulatif sera de faire advenir un ordre social que la plupart des gens n’auraient sans doute pas choisi s’il leur avait été présenté en gros. Cette approche, en terme d’ingénierie politique, s’opposait à la stratégie concurrente de la « bataille des idées ».
Les partisans de la bataille des idées commettent l’erreur fondamentale de postuler que, les cerveaux conquis, les conduites suivront. L’illusion vient des intellectuels qui, par leur position sociale, tendent à attribuer aux « idées », et en sous-main à eux-mêmes qui sont réputés en être les instigateurs, un rôle premier. Mais face aux blocages, la « pédagogie » est inutile. Il faut inverser la relation. S’il y a une leçon à retenir de Lénine, c’est que « l’action précède la théorie ».
La tâche n’est pas tant convaincre les gens que de trouver les moyens techniques de modifier leurs choix en altérant les circonstances qui en sont à l’origine. Les difficultés à « réformer » sont imputées à l’erreur de vouloir réduire l’offre gouvernementale en supprimant des prestations auxquelles leurs bénéficiaires sont attachés, sans se préoccuper en amont de faire refluer la demande sociale. La solution à ce problème allait être la « privatisation ». Cette stratégie présentait l’avantage, par contraste avec les précédentes, de ne pas faire disparaître le service du jour au lendemain, mais de le transférer à d’autres prestataires. Le pari était que les usagers, ne voyant pas tout de suite en quoi ils allaient perdre au change, et ce d’autant moins qu’on aurait laisser les services publics se dégrader au préalable, réagiraient avec moins de vigueur.
La privatisation n’est cependant pas qu’un ingénieux procédé de coupe budgétaire. Elle n’est pas tant un projet de dérégulation que de re-régulation par le marché, vue comme supérieure à toute régulation mises en œuvre par la Loi. Elle permettait du même coup de résoudre le problème de la surcharge de la demande. En convertissant les anciennes régulations politiques en demande marchande, on espérait décharger non seulement budgétairement mais aussi politiquement l’État de la pression du public. Tandis que l’usager insatisfait demande bruyamment des comptes à la puissance publique, le client mécontent se borne à changer de crèmerie (« Voter avec ses pieds plutôt qu’avec sa voix », « leur donner le choix pour qu’ils cessent de donner de la voix »).
La force de ce procédé réside en ce qu’une fois la libéralisation actée, ce sont les individus eux-mêmes, par leurs micro-choix de consommateurs, qui deviennent les moteurs du changement. C’est ce qu’on pourrait appeler, par référence à l’insecte xylophage du même nom, la politique du Capricorne : nul besoin de tailler les poutres à la hache quand, tapies dans le bois, mille petites gueules rongent inexorablement la charpente. La micro-politique n’exclut pas l’épreuve de force mais, pour chaque secteur, la réduit à une seule fois : ouvrir à la concurrence, changer un statut… Ensuite, plus besoin de guider le mouvement d’en haut, il suffit de laisser faire. C’est ce qui motive la ténacité des gouvernements libéraux dans ce type de conflit : une seule victoire décisive pour libérer les énergies dissolvantes du marché dans le secteur concerné. Ils les lisent comme des « batailles-cliquets ».
Parmi les méthodes pour contrer des bénéficiaires de l’État-providence : toujours offrir quelque chose en échange d’une perte (un avantage immédiat pour torpiller un intérêt durable), promettre le conservation des avantages en échange du sacrifice des nouveaux entrants (vendez-nous les générations futures et vous serez épargnés), mettre en place des contre-groupes (les parents qui paient deux fois en mettant leurs enfants dans le privé), etc. La micro-politique néolibérale pense à long terme et sait prendre son temps. Comme le résume un des promoteurs de cette voie : « cela prendra peut-être plus d’une génération avant que le dernier des bénéficiaires du modèle public ne fasse enfin sa sortie, mais entre-temps une offre alternative aura eu le temps de croître et de former un groupe d’intérêt efficace, ceci bien avant l’abolition finale du service d’État ». Le cœur de cible de la micro-politique néolibérale, ce sont les « classes moyennes ». Exacerber le ressentiment contre les « assistés » permet de promouvoir une stratégie de redistribution sociale en défaveur des minorités, des employés du secteur public et des travailleurs à bas salaires.
Conclusion
Le calcul stratégique pour la fin du modèle public et le triomphe sans partage du capital s’opère à l’échelle de plusieurs générations. Plusieurs décennies après la thématisation de ses principes, le processus n’est pas achevé. Pour Grégoire Chamayou, il est encore temps de le faire dérailler.
Le néolibéralisme fait miroiter l’image d’une émancipation contre les anciennes tutelles verticales de l’État. Il offre une utopie de « l’autonomie d’un entrepreneur de sa vie ». Le profit servirait « d’instrument transcendant d’une régulation globale dont tout le monde est bénéficiaire, même si momentanément, quelques-uns en sont plus bénéficiaires que d’autres ». C’est en quelque sorte la recherche d’un « art de ne pas être gouverné ». Mais cette illusion est trompeuse. L’affaiblissement des pouvoirs parlementaires, la répression des mouvements sociaux, l’amoindrissement des droits syndicaux, de la liberté de la presse, des garanties judiciaires, etc. , participent d’un même processus d’insularisation et de verticalisation de la décision souveraine. Les défenseurs d’un « État fort » ne s’accordent pas sur la même idée que cette force recouvre, mais ils s’accordent pour considérer que l’autorité de l’État doit, pour se rehausser, se délester des pressions de la « volonté populaire ».
Le versant libéral ajoute cependant une seconde dimension à l’autorité de l’État : tout-puissant dans sa sphère, cette dernière restant cependant bornée par le refus de tout interventionnisme économique, ce qui implique paradoxalement de restreindre l’autorité qu’il s’agissait de renforcer en premier lieu. Hayek n’en faisait pas mystère, cette limite interdit à l’État de toucher à l’ordre des inégalités sociales et toute politique de redistribution. Le libéralisme autoritaire est socialement asymétrique : fort avec les fables, faible avec les forts. On a beaucoup dit que le libéralisme autoritaire était un oxymore, ce serait plutôt un pléonasme.
En organisant l’ingouvernabilité des marchés, le néolibéralisme les élèvent au rang de dispositifs de gouvernance : soumettre les dirigeants à l’autorité des marchés boursiers ne fait pas disparaître celle qu’ils exercent sur leurs subordonnés. La dérégulation renforce le pouvoir de l’employeur, précarise les travailleurs, favorise l’accumulation de richesses, creuse les inégalités et par là raffermit les autoritarismes privés. C’est en ce sens que le libéralisme économique est autoritaire, pas seulement au sens étatique mais aussi social.
Dans ses dernières lignes, Grégoire Chamayou propose une piste d’où éventuellement repartir aujourd’hui : l’autogestion. Il note que l’idée selon laquelle « l’individualité dans la coopération » puisse se révéler supérieure à « la compétition dans l’individualisme » apparaissait aux néolibéraux comme un hypothèse suffisant crédible pour qu’ils dépensent beaucoup d’encre et de papier à tenter de la réfuter (mais il ne dit rien des moyens d’atteindre un tel objectif. Voir pour cela : http://imperium-online.eu/pdf/Imperium-Declaration-de-Principes.pdf).
Pour en savoir plus : Grégoire Chamayou, La Société ingouvernable, Éditions La Fabrique, ISBN : 978-2-35872-169-1.